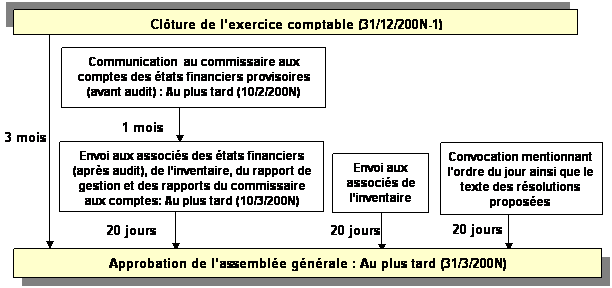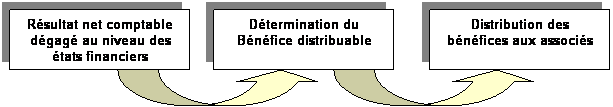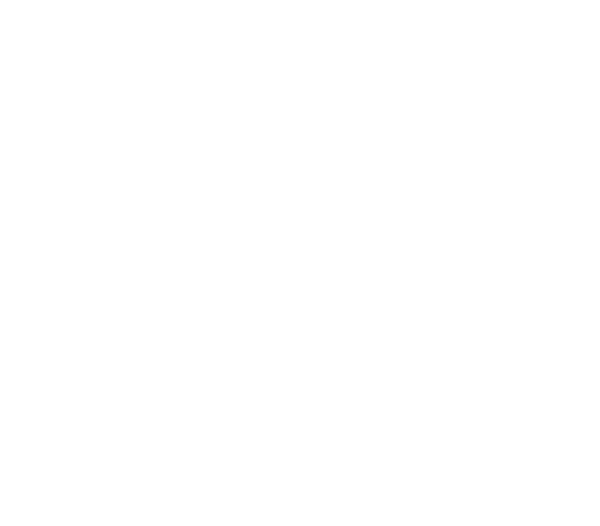|
Quatrième Chapitre L’assemblée générale annuelle dans la SARL
Section 1 : Spécificités de l’assemblée annuelle 1. L’obligation légale de tenue d’une assemblée annuelle 2. Une consultation écrite ne peut pas suppléer l’obligation de tenue d’une assemblée annuelle 3. Caractère d’ordre public des dispositions régissant l’assemblée annuelle 1. L’ordre du jour « standard » de l’assemblée annuelle 2. Les points pouvant être ajoutés à l’ordre du jour en fonction des situations § C. Le droit de communication des associés préalablement à l’assemblée annuelle 1. Etendue du droit de communication 3. Droit de l’associé de poser des questions au gérant 4. Droit de l’associé de se faire assister par un expert comptable Section 2 : L’approbation des états financiers § A. L’approbation des états financiers 1. Périodicité des états financiers 2. Contenu des états financiers 3. Qualité des états financiers 5. Délai d’établissement des états financiers 6. Publicité des états financiers § B. L'inventaire des biens de la société § D. Le rapport du commissaire aux comptes Section 3 : L’affectation des résultats § A. Schéma général d’affectation des résultats (cas d’un résultat bénéficiaire) 1. Le résultat net de l’exercice 4. Le prélèvement au titre de la réserve légale § B. Affectation des pertes sociales
Quatrième Chapitre L’assemblée générale annuelle dans la SARL Section 1 : Spécificités de l’assemblée annuelle§ A. Introduction1. L’obligation légale de tenue d’une assemblée annuelleCette obligation résulte des dispositions de l’article 128 du CSC qui dispose « L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans le délai de 3 mois[1] à compter de la clôture de l'exercice[2] ». 2. Une consultation écrite ne peut pas suppléer l’obligation de tenue d’une assemblée annuelleEn application des dispositions de l’article 126 du CSC « si le nombre des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf pour les délibérations prévues à l'article 128 du présent code ». 3. Caractère d’ordre public des dispositions régissant l’assemblée annuelleL’article 128 du CSC traite du régime des assemblées annuelles. Le sixième alinéa de cet article habilite le juge des référés à constater la nullité des délibérations prises en violation des dispositions qui y sont édictées. Enfin, le dernier alinéa répute non écrite toute clause statuaire contraire à ces dispositions. § B. L’ordre du jourL’ordre du jour de l’assemblée annuelle de la SARL comprend généralement un nombre de questions qui se reproduisent annuellement. En fonction des situations, il est généralement complété par des points exigés par la loi ou les statuts. 1. L’ordre du jour « standard » de l’assemblée annuelleL’ordre du jour « standard » de l’assemblée annuelle est généralement composé des points suivants ainsi : 1er) Lecture du rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice 200N, 2e) Lecture des rapports du commissaire aux comptes, 3e) Approbation du rapport de gestion établi par la gérance pour l’exercice 200N, 4e) Approbation des états financiers et de l’inventaire de la société de l’exercice 200N, 5e) Affectation des résultats, 6e) Approbation des conventions réglementées visées à l’article 115 du code des sociétés commerciales, 7e) Quitus à la gérance, 8e) Questions diverses, 9e) Pouvoirs pour formalités. 2. Les points pouvant être ajoutés à l’ordre du jour en fonction des situationsL’ordre du jour de l’assemblée annuelle est souvent complété par des points exigés par des circonstances particulières. Il en est ainsi pour les questions suivantes : 1er) Fixation de la rémunération de la gérance, 2e) Autorisation de certaines opérations dépassant les pouvoirs statutaires du gérant lorsque les statuts imposent des limitations aux pouvoirs du gérant, 3e) Renouvellement des fonctions de gérant ou désignation d’un nouveau gérant. 4e) La désignation ou le renouvellement du commissaire aux comptes. 5e) Réponses de la gérance sur les questions écrites des associés[3]. 6e) Etc. § C. Le droit de communication des associés préalablement à l’assemblée annuelle1. Etendue du droit de communicationPréalablement à l’assemblée annuelle, l’article 128 du CSC exige que les documents suivants soient communiqués aux associés : ‑ le rapport de gestion ; ‑ l'inventaire des biens de la société ; ‑ les comptes annuels ; ‑ le texte des résolutions proposées[4] ; ‑ le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. En outre et à tout moment, tout associé peut prendre connaissance des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices. 2. Forme de communicationLes documents susvisés doivent être communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception. 3. Délai de communicationL’article 128 du CSC prescrit un délai de 20 jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale annuelle. Par ailleurs, l’article 147 punit d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui n'ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Devant cette « contradiction juridique[5] », la prudence impose le respect du délai d’un mois pour la communication aux associés des documents prévus par l’article 128 du CSC. En revanche, la convocation de l’assemblée mentionnant l’ordre du jour et le texte des résolutions proposé peut être valablement faite en respectant le délai de vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale (Article 126 CSC). 3. Droit de l’associé de poser des questions au gérantA compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé peut poser par écrit des questions au gérant et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale[6] (Article 128 CSC). L’associé peut « poser n’importe quelle question[7] » parce qu’il s’agit d’approuver les comptes dans la gestion d’ensemble. Le droit de poser des questions écrites à la gérance exercé préalablement à l’assemblée ne vise que les questions relatives à l’approbation annuelle des comptes. Ce droit ne saurait être étendue par exemple aux questions relatives à la modification des statuts[8]. 4. Droit de l’associé de se faire assister par un expert comptableA tout moment, tout associé peut prendre connaissance des documents visés par le droit de communication concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable (Article 128 CSC). Section 2 : L’approbation des états financiersLa responsabilité d’établissement des documents soumis aux assemblées générales incombe à la gérance. L’assemblée n’est pas obligée de les accepter tels quels. Elle peut par exemple désapprouver les états financiers qui lui sont présentés. L’assemblée peut même redresser les états financiers[9]. L’approbation des états financiers intervient après la lecture et l’approbation du rapport de gestion. Elle fait suite également à la lecture du rapport du commissaire aux comptes. L’article 128 du CSC prévoit la communication de l’inventaire des biens de la société aux associés préalablement à l’approbation des états financiers. § A. L’approbation des états financiersNotons d’abord que le législateur utilise une panoplie de termes pour désigner les états financiers[10]. 1. Périodicité des états financiersLes états financiers de l'entreprise sont élaborés et présentés périodiquement, au moins une fois par an (Article 20 de la loi relative au système comptable des entreprises). 2. Contenu des états financiersLes états financiers comportent le bilan, l'état de résultats, le tableau de flux de trésorerie et les notes aux états financiers. Ces états financiers forment un tout indissociable (Article 18 de la loi relative au système comptable des entreprises). 3. Qualité des états financiersLes états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière réelle de l'entreprise, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent refléter l'ensemble des opérations découlant des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité (Article 19 de la loi relative au système comptable des entreprises). 4. Permanence des méthodesLes états financiers sont élaborés et présentés d'un exercice à l'autre en adoptant les mêmes méthodes, sauf pour les cas spécifiés dans le système comptable (Article 20 de la loi relative au système comptable des entreprises). 5. Délai d’établissement des états financiersLes délais d’établissement des comptes annuels obéissent à un nombre de contraintes :
En faisant abstraction u délai d’un mois prescrit par l’article 147 du CSC, le schéma suivant résume les différents délais prévus pour la préparation des états financiers, leur audit et leur approbation par l’assemblée :
6. Publicité des états financiersL’article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce dispose « Dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, les documents comptables qu'elles sont obligées de tenir conformément aux dispositions législatives et réglementaires les concernant ». La liste des documents sera fixée par l’article 14 de l’arrêté du ministre de la justice du 22 février 1996 relatif aux procédures du registre de commerce qui dispose « Le dépôt prévu par l'article 51 de la loi ° 95-44 du 2 mai 1995 comprend : 1- le bilan 2- les engagements hors bilan[11] 3- les rapports des commissaires aux comptes ou rapport du conseil de surveillance ». Notons enfin que les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaires (Article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de commerce). § B. L'inventaire des biens de la sociétéL'opération d'inventaire doit être réalisée, au moins une fois par exercice, à l'effet de vérifier l'existence des éléments d'actifs et de passifs et de s'assurer de leur valeur (Article 17 de la loi relative au système comptable des entreprises). Cette obligation est aussi édictée par l’article 8 du code de commerce qui oblige les personnes physiques et morales soumises à la tenue d’une comptabilité, de dresser au moins une fois par an, un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise et de porter le détail de cet inventaire sur un livre d’inventaire. Mais au-delà de l’obligation légale de tenir un livre d’inventaire[12], l’article 128 du CSC exige la communication aux associés d’un document appelé inventaire des biens de la société (قائمة إحصاء مكاسب الشركة). § C. Le rapport de gestionLa gérance de la SARL doit élaborer annuellement un rapport de gestion. Le défaut d’établissement d’un tel document est sanctionné pénalement[13]. Aucun texte ne fixe le contenu du rapport de gestion pour la SARL. Pour les sociétés anonymes ayant la qualité de société mère, le législateur fixe le contenu du rapport de gestion du groupe. L’article 473 dispose « Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce qui suit : - la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation, - l'évolution prévisible de la situation du groupe, - les différentes activités en matière de recherches, de développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés, - les événements importants survenus entre la date de clôture des comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis, - les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés groupées ». § D. Le rapport du commissaire aux comptesLe commissaire aux comptes a pour mission de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises en vigueur (Article 266 CSC). Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société. Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent (Article 269 CSC)[14]. § E. Le quitus à la géranceL'approbation des comptes d'un exercice est presque toujours suivie, dans la pratique, du vote d'un quitus donné aux gérants pour l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice en question. Toutefois, un tel quitus, bien que constituant une reconnaissance forte au bénéfice de la gérance ne peut avoir pour effet d'empêcher une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat[15]. Section 3 : L’affectation des résultatsAprès avoir approuvé les états financiers, les associés statuent sur l’affectation à donner aux résultats. § A. Schéma général d’affectation des résultats (cas d’un résultat bénéficiaire)Le résultat reçoit l’affectation suivante :
Le schéma général d’affectation des résultats est le suivant :
Certaines règles fiscales peuvent impacter ce schéma standard. Il en sera ainsi lorsque la société procède à un dégrèvement physique ou lorsque des sommes doivent être mises en réserves en application de certaines dispositions fiscales (ex. l’article 25 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001 ou l’article 39 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 etc.). Dans ces situations, le schéma général d’affectation des résultats est le suivant :
1. Le résultat net de l’exerciceLe résultat affecté correspond au résultat net comptable présenté au niveau des états financiers approuvés par l’assemblée. 2. Pertes antérieuresIl s’agit des pertes enregistrées durant les exercices écoulées. Il convient de noter que la déduction des pertes cumulées pour le calcul du bénéfice distribuable ne résulte pas du texte de la loi, mais d’un usage traditionnellement admis. Certes, le législateur n’a pas expressément prévu l’obligation d’apurer les pertes cumulées comme il l’a fait pour la société anonyme[18]. Mais, on imagine mal que la volonté du législateur serait d’autoriser la distribution dans la SARL de dividendes alors même que des pertes cumulées ne seraient encore résorbées ! 3. Le report à nouveauLe report à nouveau représente une partie des résultats laissés « en instance » par l’assemblée générale. Les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 12 « Résultats reportés ». Selon la Norme Comptable Générale « Les résultats reportés sont les résultats ou la partie du résultat dont l'affectation a été renvoyée par l'assemblée générale, qui a statué sur les comptes de l'exercice précédent. Ce compte est constitué par la somme des résultats des exercices antérieurs non encore affectés. Il est débité ou crédité des montants des effets des modifications comptables non imputées sur le résultat de l'exercice ». Le report à nouveau peut être débiteur ou créditeur. ü Lorsqu’il est débiteur, il correspond à des pertes antérieures qui doivent venir en déduction du résultat de l’exercice pour constituer la base de calcul de la réserve légale. ü Lorsqu’il est créditeur, il correspond à des bénéfices non affectés (c’est à dire non distribués et non virés à des comptes de réserves) par les associés durant l’assemblée précédente. Dans ce cas, le report à nouveau créditeur est ajouté au résultat de l’exercice courant pour la détermination du bénéfice distribuable au titre duquel l’assemblée annuelle prélèvera les distributions aux associés. 4. Le prélèvement au titre de la réserve légaleL’obligation de doter les réserves légales est prévue par l’article 140 du CSC qui dispose « Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés après chaque exercice et affectés à la constitution d'un fonds de réserves. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserves atteint le dixième du capital ». La base du prélèvement de 5% est constituée par le bénéfice net de l’exercice diminué des pertes antérieures et du report à nouveau déficitaire[19]. Le prélèvement de 5% constitue un minimum, les associés peuvent décider de doter la réserve légale par une proportion supérieure. La réserve légale constitue, comme le capital dont elle est le prolongement, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. A ce titre, elle ne peut pas être distribuée aux associés. Une grande partie de la doctrine s’accorde à autoriser l’incorporation de la réserve légale dans le capital considérant qu’une telle opération ne fait que consolider l’indisponibilité de cette réserve. Après incorporation, la réserve légale doit être reconstituée par le prélèvement annuel de 5% jusqu’à ce qu’elle atteigne 10% du capital. 5. Les réserves statutairesIl s’agit des réserves dont la constitution est prescrite par des dispositions statutaires. La décision de constituer des réserves statutaires s’impose à l’assemblée générale ordinaire appelée à répartir les bénéfices sociaux de l’exercice écoulé. La différence entre la réserve légale et les réserves statutaires réside dans la possibilité pour les associés de distribuer les réserves statutaires moyennant une décision ordinaire si les statuts les y autorisent. Cette décision aura pour conséquence de rendre disponible les réserves statutaires[20]. En raison de leur caractère contraignant, les réserves statutaires sont d’une utilisation rare en pratique. 6. Le bénéfice distribuableLe bénéfice distribuable est constitué : - Du résultat net de l’exercice ; - Diminué des sommes portées en réserves en application des dispositions fiscales ; - Diminué des pertes antérieures et du report à nouveau déficitaire ; - Diminué de la dotation à la réserve légale et aux réserves statutaires ; - Augmenté du report à nouveau bénéficiaire. 7. Les réserves facultativesLes statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à prélever sur le bénéfice distribuable toute somme qu’elle juge convenable en vue de leur affecter dans les comptes de réserves[21]. Les réserves facultatives reçoivent toute utilisation décidée par une assemblée générale (ex. apurement des pertes, distribution en espèces, incorporation au capital, etc.) 8. Les dividendesAprès affectation des réserves facultatives, l’assemblée générale décide de distribuer des dividendes aux associés. a) Proportionnalité entre dividendes et participation socialeLe droit aux dividendes est proportionnel à la quotité détenue dans le capital social. Cette règle est d’ordre public. b) Droit à la périodicité des dividendesAux termes de l’article 140 du CSC « Lorsque la société réalise des bénéfices elle doit après la constitution des réserves légales et facultatives une fois tous les trois ans au moins distribuer les dividendes. Le montant à distribuer doit représenter trente pour cent au moins des bénéfices réalisés ». Cet article pallie une pratique couramment utilisée par les associés majoritaires qui consiste à doter la totalité ou la quasi-totalité du bénéfice distribuable en comptes de réserves facultatives privant ainsi les minoritaires d’une rémunération de leur apport. c) Mise en paiement des dividendesAucune disposition légale ne fixe les conditions ou délais de mise en paiement des dividendes[22]. Les statuts ou à défaut de clause statutaire, l’assemblée peuvent organiser la mise en paiement des dividendes. d) La répétition des dividendesEn principe les dividendes reçus de la société sont définitivement acquis pour les associés. La répétition des dividendes signifie la restitution à la société des dividendes irrégulièrement encaissés. La société peut exiger des associés la répétition des dividendes qu'ils ont perçus et qui ne correspondent pas à des « bénéfices réels (والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا)[23] ». L'action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la date de perception des dividendes indus (Article 140 CSC). La répétition s’impose même aux associés de « bonne foi[24] ».
e) Distribution de dividendes fictifsContrairement aux anciennes dispositions du code de commerce[25], le CSC dépénalise le délit de distribution de dividendes fictifs. § B. Affectation des pertes sociales1. Sort des pertes socialesLorsque les états financiers dégagent une perte, l’assemblée générale peut : - Laisser subsister cette perte dans le compte « Report à nouveau ». Un tel report est prévu jusqu’au prochain exercice bénéficiaire. - Imputer les pertes sur des comptes de réserves. En choisissant la première option, les bénéfices des exercices suivants serviront en premier lieu à apurer les reports à nouveau déficitaires. Une décision extraordinaire peut imputer les pertes sur le capital social. Dans ce cas le capital social est réduit du montant des pertes. 2. Cas particulier d’une la perte rendant les fonds propres de la société inférieurs de moitié du capital socialLa situation où les fonds propres deviennent inférieurs de moitié au capital social est traitée par plusieurs dispositions du CSC :
a) Notion de « fonds propres »Les fonds propres comportent notamment les éléments suivants qu’il faut retenir à leur valeur nette comptable : - Le capital ; - Les réserves (quelle qu’en soit la nature, le régime ou l’appellation etc.) - Les subventions d’investissement ; - Les résultats reportés. b) Délai de consultation des associés pour décider s’il y a lieu de dissoudre ou non la sociétéLa comparaison entre les dispositions de l’article 142 et 147 du CSC montre une « contradiction[26] » pour ce qui est du délai de convocation ou de consultation des associés suite à la constatation des pertes : L’article 142 exige un délai de deux mois à compter de la constatation des pertes et l’article 147 parle d’un délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes pour consulter les associés. c) Régularisation par augmentation ou réduction du capitalLorsque la dissolution n’est pas décidée, les associés sont tenus de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes. Le législateur admet l’incorporation des réserves ou la réévaluation de ses fonds propres comme procédés d’augmentation de capital. Or ces deux procédés ne permettent pas d’injecter de nouveaux apports et n’appellent pas l’implication personnelle des associés dans le sauvetage de la société. L’opération de régularisation (augmentation ou réduction du capital) doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة). Mais, est ce que le terme « exercice suivant » désigne l’exercice suivant celui enregistrant la perte ayant conduit à des fonds propres inférieurs de moitié au capital ou bien désigne-t-il celui qui suit la décision de régularisation ?
Procédure à suivre lorsque les fonds propres deviennent inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes :
[1] Dans le cadre des travaux préparatoires ayant précédé la promulgation du CSC (JORT, Débats de la Chambre des Députés, Session 2001-2000, N° 4, mardi 31 octobre, p. 92), le ministère a répondu comme suit à une demande de proprogation du délai de tenue de l’assemblée annuelle à 6 mois : إقتراح تمديد الأجل إلى ستة أشهر لإعطاء الوقت الكافي للوكيل للقيام بكل ما هو مطالب به لإعداد الجلسة العامة. الجواب : إن إقتراح تمديد الأجل إلى ستة أشهر لإعطاء الوقت الكافي للوكيل للقيام بكل ما هو مطالب به لإعداد الجلسة العامة لا مبرر له من الناحية العملية بالنسبة لهذا النوع من الشركاء خاصة أن القوائم التي يتولى الوكيل تبليغها إلى الشركاء تكون وقعت مواكبتها على مدى السنة مثل القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وقائمة إحصاء مكاسب الشركة أما تقرير التصرف ونص التوضيحات المقترحة فهي لا تبرر التمديد في الأجل من ثلاثة أشهر إلى ستو أشهر. [2] La notion d’exercice est une notion comptable. Depuis la promulgation de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, la durée de l'exercice comptable est de douze mois. L'exercice débute le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Toutefois, les normes comptables peuvent fixer une date différente et ce en fonction des particularités de certaines activités. A ce jour, aucune norme sectorielle n’a autorisé de dates d’ouverture et de clôture différentes des prescriptions de l’article 22 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises. Sur le plan fiscal, la notion d’exercice doit être interprétée en termes de période dont les résultats servent de base pour l'établissement de l'impôt, qui est généralement de 12 mois et qui peut être inférieure dans des cas particuliers (cf. Note Commune 10/93). [3] A compter de la communication légale des documents aux associés, tout associé peut poser par écrit des questions au gérant et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale. Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale. [4] Le texte des résolutions doit être mentionné dans la convocation à l’assemblée. L’article 126 du CSC dispose, en effet, que « La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle mentionne clairement l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées ». [5] A. OMRANE, Les problèmes suscités par l’entrée en vigueur du Code des Sociétés Commerciales, Etudes juridiques, Revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax, N°8, 2001, p. 26 [6] Parallèlement à ce droit prévu par l’article 128 du CSC au profit des associés de la SARL, l’article 138 du CSC énonce un droit similaire en disposant « Tout associé non gérant pourra deux fois par exercice poser une question écrite au gérant sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un péril. Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le mois de la réception de la question. Sa réponse doit être obligatoirement communiquée au commissaire aux comptes s'il existe un ». [7] Y. GUYON, op. cit., p. 531 [8] Dans le cadre des travaux préparatoires ayant précédé la promulgation du CSC (JORT, Débats de la Chambre des Députés, Session 2001-2000, N° 4, mardi 31 octobre, p. 92), le ministère a apporté les précisions suivantes : السؤال : 169 : ما هي كيفية طرح الأسئلة الكتابية (رسالة عادية أو مضمونة الوصول) وهل يمكن أن تخرج الأسئلة عن مواضع جدول الأعمال ؟ الجواب : يمكن طرح الأسئلة بأية وسيلة كتابية تترك أثرا ثابت التاريخ كالرسائل البريدية المضمونة الوصول والفاكس والتلاكس والرسائل المعلوماتية وغيرها من وسائل الإثبات الكتابية والمعتمدة في التشريع التونسي وخاصة الرسائل الحديثة التي إعتمدت في تنقيح مجلة الإلتزامات والعقود فيما يتعلق بوسائل الإثبات والحجج الرسمية وغير الرسمية. وتتعلق هذه الأسئلة الموجهة إلى الوكيل بتوضيحت حول مضمون الوثائق التي وجهها الوكيل إليهم برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ والتي وردت بالفقرة الثانية من هذا الفصل وهي تقرير التصرف، قائمة إحصاء مكاسب الشركة، القوائم المالية، نص التوصيات المقترحة، تقرير مراقب الحسابات عند الإقتضاء. [9] En France, une réponse ministérielle reconnaît à cet effet, le pouvoir souverain de l’assemblée. Le ministre français de la Justice a souligné à cet égard que le formalisme de la loi du 24 juillet1966 ayant trait notamment à la communication préalable des comptes aux associés et aux commissaires aux comptes ne fait pas par lui-même obstacle au droit souverain de l'assemblée de modifier les comptes qui lui sont présentés (Rép. Mario Bénard et Henri Arnaud, JO 15 janvier 1972, Déb. AN pp. 105 et 106 ; Rapportée in La Revue Fiduciaire, RF N° 852, mai 1998, p. 158). [10] Pour les seules dispositions traitant de la SARL : L’article 96 du CSC évoque des un « bilan annuel ». Dans l’article 128 du CSC, le législateur utilise les termes « comptes de gestion » et « comptes annuels ». Dans l’article 142, l’expression « documents comptables » est utilisée. L’article 146 reprend le terme « comptes annuels ». Enfin, l’article 147 prévoit des sanctions pour les gérants qui ne communiquent pas le « bilan » aux associés. [11] Les engagements hors bilan font partie des notes aux états financiers (cf. Norme Comptable Tunisienne N° 14 « Eventualités et évènements postérieurs à la clôture »). [12] Les éléments d'actifs et de passifs inventoriés sont regroupés sur le livre d'inventaire selon la nature de chaque élément inventorié et le mode de son évaluation. Le livre d'inventaire est tenu d'une manière, conforme aux normes comptables, permettant la justification de tous les éléments des états financiers (Article 17 de la loi relative au système comptable des entreprises). Les états financiers sont portés sur le livre d'inventaire (Article 20 de la loi relative au système comptable des entreprises). [13] L’article 147 du CSC punit d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants qui n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de gestion. [14] Les articles 266 et 269 du CSC traitent du commissaire aux comptes dans la société anonyme. En vertu des dispositions de l’article 125 du CSC, les pouvoirs, fonctions, obligations et responsabilités, de même que les conditions de révocation et de rémunération des commissaires aux comptes de la SARL sont fixés selon les dispositions des articles 259 à 273 du CSC. [15] v. Article 119 du CSC « Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de l'assemblée générale ayant pour effet d'interdire l'exercice de l'action en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l'exercice de son mandat ». [16] Dans certaines situations, les constitutions de comptes de réserves en vertu des dispositions fiscales imposent un prélèvement sur les bénéfices avant même l’imputation des reports déficitaires antérieurs. [17] Le compte spécial d’investissement est prélevé avant tout autre prélèvement, mais la réserve légale est calculée sur le montant des bénéfices « bruts » diminués éventuellement du report à nouveau déficitaire. [18] Dans la société anonyme, ce fait a été confirmé par l’article 287 du CSC qui dispose « Peut être annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables au titre de réserve légale ». Aussi, l’article 288 du CSC interdit implicitement la distribution de dividendes sans que les pertes antérieures n’auraient pas été apurées. [19] L’on notera que le texte de l’article 140 du CSC ne prévoit pas expressément une telle disposition. Dans les sociétés anonymes, l’article 287 dispose « Peut être annulée toute délibération qui n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables (الخسائر الباقية للتأجيل) au titre de réserve légale ». [20] Il est utile que la possibilité de prendre une décision ordinaire pour mettre en distribution les réserves statutaires soit mentionnée avec précision dans les statuts. [21] Les comptes de réserves facultatives reçoivent plusieurs appellations « Réserves extraordinaires », « Réserves de générales », « Réserves de prévoyance » etc. [22] Pour le cas particulier des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, l’article 17 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier prescrit un délai maximum de trois mois à partir de la décision de l'assemblée générale pour la mise en paiement des dividendes décidée par cette assemblée générale ordinaire. [23] Aucune définition n’est donnée par le législateur pour les bénéfices irréels. [24] P. MERLE, op. cit., p. 213 [25] L’article 169 du code de commerce (article abrogé par l’article 2 de la loi n° 2000‑93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales) prévoyait de lourdes sanctions pénales à l’encontre de « gérants qui en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux ont opéré entre les associés une répartition de dividendes fictifs ». [26] A. OMRANE, op. cit., p. 26 |